- bord avant de la plinthe avec petit endroit abîmé, légères traces d'oxydation au niveau du buste, un peu frotté par endroits, dans l'ensemble en très bon état pour l'âge
- L'éclat doré de l'imagination -
Albert-Ernest Carrier-Belleuse nous transporte à l'époque des Très Riches Heures, le livre d'heures du duc de Berry réalisé entre 1485 et 1489 par les frères Limbourg. Sa lectrice semble sortir du monde du livre d'heures, tout en réfléchissant elle-même à l'acte de lecture. Son vêtement orné d'une très riche broderie de brocart, qui exige une précision extrême de la fonte du bronze, la désigne comme une élégante dame de cour. Elle est plongée dans la lecture d'un livre, qui pourrait également être un livre d'heures, comme l'indiquent la reliure richement ornée et le format. Alors que la dame tient le livre d'une main et les pages ouvertes avec le pouce, les doigts de l'autre main tournent déjà la page suivante, illustrant ainsi le processus de lecture. Si son visage rayonne d'une beauté silencieuse et presque immobile, le drapé en cascade extériorise l'agitation intérieure. Comme une sainte de l'époque, elle a resserré son vêtement de dessus avec l'avant-bras, créant ainsi d'élégants drapés qui dramatisent le visage.
Carrier-Belleuse a expérimenté des méthodes galvaniques pour argenter et dorer les surfaces des sculptures en bronze. La Liseuse, pour laquelle l'artiste a reçu le Grand Prix du Salon de Paris, est un exemple remarquable de cette technique innovante. L'apparence dorée rappelle le fond d'or de l'époque « sacrée » disparue, rendue présente par la Lesende. En même temps, la représentation picturale de la lecture nous ouvre le royaume de l'imagination.
Sur l'artiste
Après un apprentissage de ciseleur et d'orfèvre à Paris, Albert-Ernest Carrier-Belleuse entreprit en 1840 des études à l'École des Beaux-Arts sous la direction de Pierre-Jean David d'Angers, mais tourna rapidement le dos à l'art académique pour rejoindre la « Petite École », qui devint en 1877 l'« École nationale des arts décoratifs ». En 1848, il s'installe en Angleterre et travaille comme dessinateur pour la célèbre usine de porcelaine et de faïence Herbert Minton à Stoke-upon-Trent. Il réalise également des projets pour Wedgewood et Copeland, pour le fabricant de fonte Coalbrookdale et pour la manufacture de meubles Graham & Jackson. Même après son retour à Paris en 1855, il continua à fournir des modèles aux manufactures britanniques tout au long de sa carrière artistique.
À Paris, il ne cessa de fréquenter le Salon de Paris à partir de 1857 et devint rapidement un artiste très demandé. Napoléon III acheta la statue de marbre « Bacchante » présentée en 1863 pour les jardins des Tuileries (aujourd'hui au musée d'Orsay) et loua Carrier-Belleuse comme « notre Clodion », faisant ainsi référence au sculpteur du XVIII^e siècle le plus admiré en France, Claude Michel gen. Clodion (1738-1814) fut le sculpteur du XVIIIe siècle le plus admiré en France. L'estime de l'empereur conduisit à d'autres acquisitions par l'État. En 1867, le « Messie » du Salon, décoré de la médaille d'honneur, fut acquis pour l'église parisienne de Saint-Vincent-de-Paul, ce qui valut en outre à l'artiste la croix de la Légion d'honneur. « L'Hébé endormie » de 1869 a même été commandée par l'État et se trouve également aujourd'hui au musée d'Orsay.
Carrier-Belleuse a également réalisé de nombreux bustes-portraits de personnages contemporains et historiques. Il a notamment représenté Napoléon III, Eugène Delacroix, Honoré Daumier, Théophile Gautier et son grand modèle Jean-Antoine Houdon. Son œuvre comprend également des monuments monumentaux tels que le « Maréchal Masséna » à Nice (1869) ou le monument équestre à l'union de la Valachie, de la Transylvanie et de la Moldavie à Bucarest (1876).
En 1871, Carrier-Belleuse et Auguste Rodin fuirent la Commune de Paris et se réfugièrent à Bruxelles, où ils réalisèrent sous sa direction une frise à la nouvelle Bourse. L'une de ses activités artistiques les plus importantes après son retour à Paris fut certainement ses créations pour le Nouvel Opéra de Charles Garnier, avec lequel il était ami tout comme avec Jean-Baptiste Carpeaux. À partir de 1875 et jusqu'à sa mort en 1887, Carrier-Belleuse fut directeur artistique de la manufacture de porcelaine de Sèvres, qui connut sous sa direction une nouvelle période de prospérité. De 1877 à 1883, Auguste Rodin travailla également à Sèvres pour Carrier-Belleuse, dont Rodin réalisa un buste en terre cuite en 1882.
Outre ses innovations artistiques, qui ouvraient le classicisme académique à une nouvelle sensualité orientée vers le naturalisme, Carrier-Belleuse développa également des innovations techniques. Il expérimenta des méthodes d'affinage galvanique des sculptures en bronze.
A partir de 1885, une maladie oculaire incurable le rendit progressivement aveugle. La même année, l'artiste, qui avait été fait chevalier de la Légion d'honneur en 1867, fut nommé officier de la Légion d'honneur.
Albert-Ernest Carrier-Belleuse signait ses œuvres « A. Carrier » et, à partir de 1868 environ, « A. Carrier-Belleuse ».
























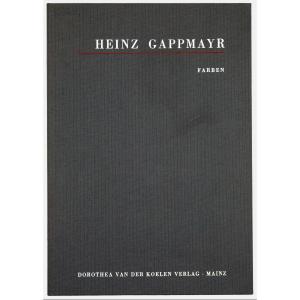



















 Le Magazine de PROANTIC
Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine
TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato
Rivista Artiquariato