La diseuse de bonne aventure dans les ruines romaine
Huile sur toile signée en bas à droite « J. ROOS fecit » et datée 1678 en dessous la signature
Dimension : 93 x 108 cm
Dimension avec cadre : 111 x 127 cm
Bibliographie
Né dans le Palatinat, Johann Heinrich Roos subit toutes les conséquences tragiques de la guerre de Trente Ans. Sa famille, calviniste, se réfugie à Amsterdam en 1640 et l’artiste se forme auprès des peintres animaliers hollandais. Ses maîtres sont Guilliam de Gardijn (vers 1597-après 1646 ; il ne faut pas confondre cet artiste avec Carel du Jardin), Cornelis de Bie et Barent Graat. Un voyage en Italie n’est pas documenté (vers 1650). En tout cas, l’artiste vit dès 1653 à nouveau en Allemagne où il entre au service de l’électeur du Palatinat. En 1667, ce peintre et dessinateur infatigable préfère s’installer avec sa famille à Francfort, ville commerciale lui permettant de mieux vendre ses productions. Il y meurt dans l’incendie de sa maison.
Marqué par les pastorales de Nicolas Berchem, il s'est particulièrement illustré dans la peinture de paysages peuplés d'animaux. Il fut reconnu comme portraitiste mais était plus apprécié comme peintre animalier.
Ses œuvres se retrouvent aujourd’hui dans les plus grands musées du Monde, Louvre, Palais pitti, Ermitage et dans la majorité des grands musées Allemands.
L'œuvre présentée incarne parfaitement le style caractéristique de l'artiste. La scène de genre, située dans les ruines et peuplée d'animaux, a contribué à sa renommée. Toutefois, le sujet abordé dans cette peinture s'avère quelque peu atypique. Si la diseuse de bonne aventure connaît un grand succès au XVIIe siècle, ce thème est relativement rare dans l'œuvre de l'artiste. Certaines de ses œuvres, telles que celles conservées au Städel Museum (photo 10) et au Musée de l'Ermitage (photo 11), évoquent cependant les familles de Gipsy. Ici, il semble que cette famille ait établi son campement dans des ruines antiques. Nous apercevons une partie de la famille occupée à préparer un potage en arrière-plan, des enfants jouant aux cartes et, probablement, la matriarche qui s'apprête à lire l'avenir d'un couple noble se promenant dans l'arrière-pays romain.
Ce tableau constitue un remarquable exemple de ce que pouvait être l'art du XVIIe siècle, avec un subtil mélange des genres : les ruines, la palette de couleurs typiquement italienne, l'attention au détail et la scène de genre d'inspiration plus nordique (comme l'anecdote discrète en haut à droite, où l'on voit une personne se soulageant derrière un rocher, tandis qu'un chien s'en approche avec curiosité).




























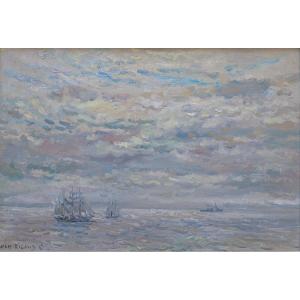




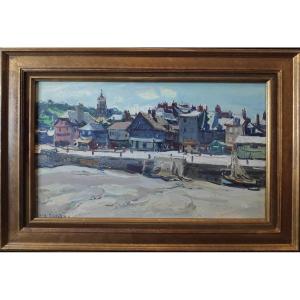














 Le Magazine de PROANTIC
Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine
TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato
Rivista Artiquariato