Crucifix
Ivoire et lapis lazuli, cm 28x16
L’œuvre est accompagnée d’un certificat communautaire CITES
Le lapis-lazuli (ou lapis-lazuli) est l’une des pierres précieuses connues depuis les temps anciens. L’étymologie du nom vient du latin lapis, "pierre" et du latin médiéval lazulum, "bleu". La première utilisation de cette gemme remonte au V millénaire avant notre ère, à l’époque où elle était très utilisée, par exemple, pour la fabrication des bijoux trouvés dans les tombes pharaoniques en Egypte.
Les peintres avec le lapis-lazuli obtenaient, grâce au broyage et à d’autres procédés, la couleur bleue la plus précieuse pour les fresques médiévales : la teinte était intense et extrêmement résistante dans le temps. Le coût de cette matière première était comparable à celui de l’or, si l’on pense que les seules mines connues étaient en Afghanistan. La richesse du matériau avait aussi une signification dévotionnelle : dans l’art sacré, représenter la divinité avec des matériaux précieux était une sorte d’offrande faite à son égard.
Même à l’époque babylonienne, ce matériau était particulièrement utilisé. On peut en effet constater l’utilisation du lapis-lazuli dans la célèbre porte d’Ishtar qui servait d’entrée principale à la grande ville de Babylone.
Dans l’ère moderne, célèbres sont les coupes et les vases en lapis-lazuli qui ont appartenu aux Médicis. Michel-Ange en a fait un usage abondant pour les fresques de la Chapelle Sixtine (en particulier dans le Jugement Dernier) et de la Chapelle Pauline (Conversion de Saul et Crucifixion de saint Pierre). À Rome, dans l’église du Gesù, au sommet de l’autel de saint Ignace de Loyola, se trouve une grande sphère de lapis-lazuli (le plus grand bloc connu).
C’est précisément au fort gradient symbolique du lapis-lazuli que fait référence l’auteur de ce crucifix du XVIIe siècle, qui associe le matériau à un autre élément extrêmement rare et d’une grande valeur, l’ivoire, qui est ici finement sculpté.




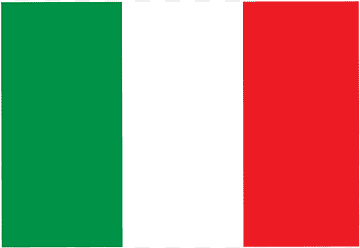 Vedi questo oggetto sul sito italiano
Vedi questo oggetto sul sito italiano





















 Le Magazine de PROANTIC
Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine
TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato
Rivista Artiquariato